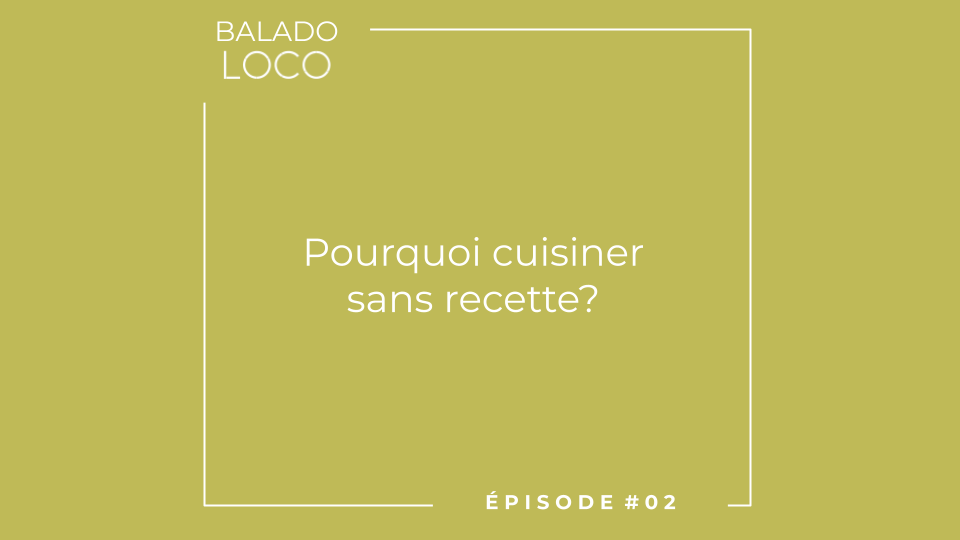Pourquoi cuisiner sans recette ? À travers ce balado on répond à cette intrigante notion de préparer des repas sans suivre de recette. Parallèlement on aborde entre autres les obstacles du “manger local” et comment, en tant que citoyen.ne, on peut dépasser ces freins en adoptant de nouvelles pratiques culinaires.
Ainsi, pour notre invitée Véronique Bouchard, cuisiner sans recette est le meilleur moyen de développer notre résilience alimentaire !
Pour écouter le balado
Apple | Google | Spotify | Youtube
Biographie de l’invitée
Véronique Bouchard est fermière et épicière de famille à la Ferme aux petits oignons, située à Brebeuf dans la région des Laurentides. Femme aux multiples talents, elle est agronome, conférencière, mère de deux beaux enfants et citoyenne écoféministe engagée dans sa communauté ! Véronique est également l’autrice du livre Cuisiner sans recettes, un guide de résilience alimentaire paru chez Écosociété en octobre 2020 au Canada et en février 2021 en Europe. Dans ce magnifique livre elle y explique pourquoi il est important d’apprendre à cuisiner sans recette. C’est d’ailleurs là pour elle, un “anti-livre de cuisine qui réinvente nos façons de préparer et de consommer nos aliments”.
Version écrite de l’entretien
Pourquoi avoir écrit un anti-livre de recette “Cuisiner sans recette”?
En étant fermière de famille depuis 16 ans, à chaque semaine je dois écrire à mes abonné·es pour leur donner de nouvelles de la ferme, leur parler du contenu du panier, et je dois aussi fournir des recettes, des trucs pour savoir comment cuisiner et apprêter les légumes. C’est comme ça que je me suis rendue compte que pour une bonne partie de nos abonné·es, le manque de connaissances pour pouvoir manger de saison et être capable de cuisiner à partir de ce qui est disponible au lieu de suivre des recettes, était un frein important à faire des changements.
Les gens ont souvent la volonté de faire des changements, pour manger plus local, plus de saison, … C’est vraiment avec le panier où ils demandent comment je nourrie ma famille à partir de ces légumes qui sont pas toujours des légumes qu’on connait. Ou comment être capable de suivre une recette même si j’ai pas tous les ingrédients?
C’est comme ça que m’est venu l’idée de créer un livre pour que les gens développent leurs connaissances, leur confiance et leur créativité pour être capable de cuisiner à partir de ce qui est disponible.
C’est sûr que c’est dans un contexte où je suis fermière de famille avec des légumes bios, mais on l’a vu aussi avec la pandémie, dans notre épicerie il y a des jours où on manquait des oeufs, du tofu, des ingrédients vraiment de base. Donc on a été obligé d’accompagner nos clients et de leur dire on n’a pas d’oeufs en ce moment, mais selon ce que tu voulais cuisiner, peut-être que tu pourrais utiliser de la graine de lin ou une banane écrasée.
C’est d’autant plus important dans un contexte de changement climatique, où on nous annonce qu’il va y avoir de plus en plus d’évènements climatiques extrêmes, d’autres pandémies, … les bris d’approvisionnement qu’on a connu durant la crise de la COVID, ça risque d’être de plus en plus fréquent.
D’où l’importance de développer nos aptitudes et nos habiletés pour faire face à ces changements là et développer individuellement et collectivement notre résilience alimentaire, notre capacité à faire face à des perturbations.
Pour toi c’est quoi une résilience alimentaire?
Le terme résilience c’est un terme qui est issu de la physique, c’est la capacité d’un matériaux ou d’un métaux à résister aux chocs. Ensuite, le concept de résilience a été extrapolé en psychologie et plein d’autres sphères de la science. Finalement, c’est cette capacité d’un système à résister aux chocs.
Quand on parle de résilience alimentaire, c’est la capacité de pouvoir continuer à se nourrir adéquatement, sainement, en bonne quantité, en bonne qualité, malgré d’éventuelle perturbations.
Je crois beaucoup que la résilience de nos systèmes alimentaires passent aussi beaucoup par la solidarité. Les liens solidaires qu’on crée entre les produteurs et les mangeurs, les producteurs entre eux. Et je trouve que le concept de fermier de famille, l’abonnement aux paniers bios solidaires est un bel exemple. On a des liens solidaires entre des abonné·es et une ferme qui nourrit directement ces abonné·es là. Au niveau du réseau des fermiers de famille, on a une solidarité entre les fermiers. De sorte que – comme c’est arrivé dans les années dernières – une ferme est affectée par la grêle, toutes les autres fermes du réseau se joint pour fournir des légumes ou pour continuer à approvisionner les abonné·es, pour permettre à cette ferme-là de passer le coup difficile. La grêle c,est le pire cauchemar, ça peut charcuter un champ au complet en l’espace de quelques minutes. Ce sont des pertes énormes, mais le fait d’avoir ce réseau solidaire, on se sent ensemble plus fort et capable de faire face à des perturbations et des évènements climatiques extrêmes.
Est-ce que vous retrouvez autant de support et de solidarité dans vos relations avec les institutions publiques?
Si on parle d’institution publics on parle du Ministère de l’agriculture ou de la financière agricole, c’est assez paradoxale. Parce qu’avec La Ferme aux petits oignons on a gagné des concours, on a gagné le prix de la relève du MAPAQ pis on a gagné aussi le prix Tournez-vous vers l’excellence de la financière agricole. Puis il y a plusieurs autres entreprises, la CAPÉ (Coopérative d’agriculture de proximité écologique), le réseau des Fermiers de famille qui ont gagné ces concours là. Donc on se retrouve souvent sur la page couverture du plan d’action du MAPAQ, mais dans les faits, dans les politiques ou quand on parle aux dirigeants du MAPAQ ou de la financière agricole, bien là tout d’un coup on est une agriculture marginale, de niche, de créneau.
On aime ça présenter l’image de nos entreprise à la population comme étant l’agriculture du Québec, ça paraît bien une belle petite ferme bio. Mais quand vient le temps de soutenir cette forme d’agriculture, malheureusement on soutien encore beaucoup l’agriculture à l’exportation qui permet d’avoir une balance commerciale positive, mais qui n’est pas nécessairement l’agriculture qui nourrit les Québécois·es.
Dans les moyens que tu nommes pour augmenter notre résilience il y a: augmenter notre population agricole, augmenter l’agriculture nourricière et augmenter les circuits courts. C’est donc ce modèle qui devrait être promu?
On parle beaucoup en ce moment d’autonomie alimentaire. Personnellement j’aime bien ramener le concept de résilience. Pour être autonome avec de très grandes fermes – de type monoculture ou d’élevage industriel – si une entreprise doit nourrir des milliers et des milliers de personnes, et que cette entreprise-là subit de la grêle, une maladie… Bien à ce moment-là, on n’est pas nécessairement résilient. Et j’aime bien rappeler que le rôle d’une agriculture de proximité basée sur plusieurs petites fermes joue un rôle de résilience, mais aussi d’occupation du territoire, de dynamisation du milieu rural.
L’agriculture a eu au Québec un rôle très important dans l’économie, le dynamisme des communautés rurales. Mais avec l’agrandissement des fermes, la diminution du nombre d’agriculteurs, ça a amené une diminution des populations, la fermeture des écoles, de la station-service, du dépanneur, de l’épicerie… Il y a donc toute une perte de services qui vient avec des fermes de plus en plus grosses.
Il faut donc reconnaître tous les rôles de l’agriculture et il faut sortir de ce biais culturel là où on cherche au Québec à payer toujours le moins cher possible pour notre alimentation, alors qu’on est une société riche. C’est vrai qu’il y a toujours une tranche de la population qui est en situation d’insécurité alimentaire, mais on devrait plutôt avoir des mesures ciblées pour ces personnes-là. Pour le reste de la population, il faudrait être prêt à payer le juste prix, ou que du moins, le consommateur soit cohérent avec son discours citoyen. On a souvent la même personne qui va exiger du bien-être animal, la réduction des pesticides, etc. mais qui une fois à l’épicerie, dans son rôle de consommateur, va chercher le prix le moins cher possible. Donc il y a un tout un travail collectif et des instances gouvernementales qui devraient viser à valoriser notre agriculture pour que les gens soient prêts à payer le prix que ça vaut le bien-être animal, la protection de l’environnement. Culturellement, il y a un changement important qui doit être fait. Les gens sont capables de se payer des voitures de luxe, des Netflix, des Spotify… mais quand vient le temps de s’abonner à un panier bio, ben là ça coûte cher.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut manger plus localement en fonction des saisons?
Oui, je le présente comme un retour à l’alimentation saisonnière. Ça peut apporter beaucoup de plaisir et ça permet de briser la monotonie de l’abondance à l’année. Si on mange des fraises à l’année, c’est comme plus spécial quand les fraises du Québec arrivent. Alors que si on mange de saison, c’est la saison de l’été, c’est le bon petit concombre de champs. Quand arrive l’automne, je n’ai plus envie de manger des concombres et des tomates. J’ai envie de manger des courges… il commence à faire froid, on se fait des petits potages réconfortants. Donc d’avoir cette diversité-là à travers les saisons, c’est beaucoup moins monotone que de manger la même chose à l’année.
Souvent je donne l’exemple des couleurs au Québec, quand les arbres changent de couleurs à l’automne on trouve ça magnifique! Mais probablement que si nos arbres étaient colorés comme ça à l’année, on finirait par ne plus les voir. Donc d’avoir cette alternance-là entre l’été, la neige, les couleurs, le petit vert du printemps… on peut avoir le même émerveillement gustatif à travers les saisons.
On peut aussi en faire des activités rassembleuses et saisonnières. Au lieu de le voir comme une corvée individuelle – je m’identifie beaucoup au mouvement féministe, éco-féministe – je ne veux absolument pas mettre de pression sur aucune femme en imposant le besoin de faire nos conserves. L’idée c’est plutôt de les faire gars et filles ensemble, entre ami·es, en famille. Et en faire des activités où – au lieu d’aller passer ton samedi au centre d’achat – tu passes ton samedi entre ami·es à faire tes conserves de tomates, à faire ton pesto. Le faire ensemble c’est aussi une occasion d’apprendre. Parce que ça peut être intimidant si on n’a jamais fait ses conserves ou son pesto. En le faisant entre ami·es on peut échanger des trucs aussi – ha moi je congèle mon pesto dans des cubes à glaçons, ha moi je le congèle dans des petits pots.
Dans le livre je présente aussi tous les procédés intéressants pour la transformation. Moi j’adore la congélation! Je suis fermière et mère de famille, donc je n’ai pas le temps de cuisiner! Il faut que ce soit rapide et efficace. Dans les premières années, je ne voulais avoir aucune perte. Donc après ma grosse journée de travail, je faisais des cannes jusqu’à 11h30 le soir… et à un moment donné j’ai découvert que je pouvais juste mettre mes tomates dans le congélateur… et l’hiver, quand c’est plus relaxe pour moi, je peux sortir des tomates, je peux faire chauffer mon fourneau. Et là, je réalise que c’est bien plus logique de faire chauffer mon four en novembre ou décembre quand il fait froid, pour réchauffer la maison. Pour la congélation me permet de réduire mon gaspillage et de reporter à plus tard la transformation. Quand tu pars pour une semaine, tu transfères tout ce que tu as dans le frigo dans le congélateur et quand tu reviens, tu gères ça. Je trouve que la congélation mérite de retrouver ses lettres de noblesse. C’est économique, écologique, super facile et ça permet de manger local à l’année! Les fraises de saison ne sont pas chères, on peut les congeler et faire toutes sortes de dessert, les mettre dans nos smoothies et manger des fraises durant l’hiver aussi.
Dans ton livre, tu présentes aussi deux grands types de cuisiniers, est-ce que tu peux nous les présenter?
Oui! J’ai essayé de faire des caricatures. Il y a la personne qui part de la recette et qui la suit à la lettre, que j’appelle le conformiste ou le conservateur. Et il y a la personne qui cuisine sans recette – moi je suis de ce type-là. Ma mère suivait les recettes à la lettre, donc j’ai grandi dans cette culture-là de suivre une recette et où chaque étape est importante. Et maintenant, j’ai de la misère à suivre une recette et je fais un peu à ma tête. Parce qu’une fois qu’on a compris les principes de base, on comprend comment on peut modifier les recettes et on n’est plus obligé de les suivre à la lettre. On peut l’adapter à notre goût (moins sucré).
Pour les gens qui sont intimidés par le fait de cuisiner sans recette. Ou même juste par l’idée de cuisiner. Et je me suis interrogée sur le fait de pourquoi certaines personnes ont absolument besoin de la recette, pourquoi d’autres personnes sont capables d’ouvrir le frigo et de faire avec ce qu’il y a. J’en suis arrivée à la conclusion que c’est soit un manque de confiance, de connaissances ou de créativité. Je fais le parallèle avec la musique. J’ai étudié la musique classique avec des partitions et c’est drôle, parce qu’autant je cuisine sans recette, autant j’ai bien de la difficulté à faire de l’improvisation. Parce que je suis un peu prise dans mon carcan de la partition. Ça me permet donc un peu de comprendre ceux qui sont pris dans le carcan de la recette.
J’aime bien faire le parallèle avec l’image corporelle positive. C’est sûr que quand tu regardes des magazines de mode avec des photos retouchées, instagram, c’est très difficile après ça de se regarder dans le miroir et tant que femme, ou homme maintenant, et de se dire “ha je suis satisfaite de mon image corporelle”. Je trouve qu’avec la cuisine c’est un peu la même chose.
C’est comme si la cuisine, fallait absolument être chef, fallait absolument que ce que tu vas manger ça ait l’air d’une photo Instagram. Mais c’est sûr que la cuisine de tous les jours on ne va pas toujours mettre des artifices. Je pense que de se couper un peu de cette image-là Instagram très liché, ça peut nous aider à regagner confiance.
Pas besoin d’être chef pour cuisiner. Tout le monde doit cuisiner. Partout à travers le monde, des gens doivent cuisiner pour se nourrir. Donc ce n’est vraiment pas réservé à une élite. Ça peut être très bon, savoureux, sain, nutritif, sans que ce soit une recette estampée Ricardo.
AL: moi je suis vraiment dans la catégorie sans recette. je suis incapable de suivre une recette, ça décourage vraiment mon chum… il faut tout le temps que je change quelque chose à la fin qui ne me convenait pas. Je pense que c’est la confiance, mais c’est la confiance aussi de savoir que ça ne sera pas toujours bon. Des fois on se trompe, ce n’est pas bon, mais on le mange quand même. C’est pas grave, c’est sûr que ça arrive que tu vas te tromper si tu testes des affaires intuitivement. C’est de se dire que parfois ça ne sera pas bon, mais ce n’est pas super grave. Et d’autres fois, ça va être exquis, et il faut juste en profiter.
C’est vrai que lorsqu’on parle de changement de culture, de sortir de cette culture de la performance qui parasite plusieurs sphères de la société. Et les médias sociaux exacerbent beaucoup ça, parce qu’on va mettre des belles photos, des belles images. Ce qu’on met sur les médias sociaux, c’est les succès de nos entreprises. Mais tous les échecs de nos entreprises, on n’en parle pas, c’est tabou. Alors que lorsqu’on s’intéresse un peu aux sciences de la gestion, tous les entrepreneurs ont vécu des échecs. Au niveau individuel, on vit tous des échecs. On a beau regarder nos amis avec toutes les photos où ils ont l’air heureux en couple.. mais les couples se chicanent tous! haha! Cette culture-là de dire “tout est parfait”, c’est faux.
Et c’est vrai aussi en cuisine, même quand on va au restaurant. Ça m’arrive de commander un plat au restaurant et de ne pas aimer ça (trop salé ou j’aime pas la cuisson). Donc même au restaurant ça arrive, parce qu’on a tous des goûts différents et au fond ce sont des humains. Ça peut arriver à tout le monde d’échapper la salière… même aux chefs charismatiques qu’on voit à la télé ou sur les médias sociaux.
L’expérimentation c’est une méthode d’apprentissage. Je valorise beaucoup de s’intéresser ax principes de base d’une recette. Au lieu de prendre une recette, je vais regarder 3-4 recettes de quiches et je vais comprendre le concept: d’habitude une quiche ça va être entre 4 et 6 oeufs, des on met peu de lait, parfois non… donc j’imagine que ça dépend si les autres ingrédients contiennent de l’eau aussi. En analysant, on comprend le rôle de chaque ingrédient, les principes de base. Et une fois qu’on a compris ça, et qu’on en a fait quelques fois… après ça on ‘a plus besoin de recette.
Tu parles aussi d’astuces pour conserver nos aliments et tu fais la distinction entre les fruits climatériques et non climatériques.
Oui, ça, c’est dans les fruits et légumes. C’est la capacité d’un fruit à continuer à mûrir après avoir été cueilli. En écrivant le livre, je me suis documenté et je connaissais beaucoup les légumes parce qu’on est maraîcher. Je sais que lorsqu’on entrepose nos pommes, il ne faut pas les mettre avec nos carottes ou nos panais, car l’éthylène va stimuler le développement d’un composé qui donne un goût amer.
Il y a certains fruits ou légumes qui vont répandre de l’éthylène, ça que ça va les aider à mûrir ou soit qu’ils vont passer le stade de mûrissement et dépérir. Ou encore développé d’autres problèmes comme le goût amer. Le fait de mettre des pommes avec des pommes de terre ça empêcherait la germination.
Donc toutes ces interactions, si on ne les connaît pas et qu’on met dans notre tiroir des pommes et des carottes… bien les carottes vont rapidement goûter amer après quelques jours. Ce sont donc des détails super importants pour contrer le gaspillage alimentaire.
Quand on parle du frein au changement, on parle toujours du prix du bio, le prix du local – oui, mais c’est plus cher -, mais quand on réalise qu’au Canada on gaspille près de 60% des aliments… si on diminue le gaspillage alimentaire, on fait des économies qu’on peut après ça investir dans des meilleurs choix. Au lieu de vouloir chercher des aliments au plus bas prix, il faut faire en sorte de réduire le gaspillage alimentaire.
Dans l’organisation du frigo, je mettais souvent ma pinte de lait dans la porte… mais ce n’est vraiment pas là qu’il faut mettre le lait si on veut être sûr de ne pas en perdre. Souvent faire le tour de son frigo pour voir ce qui doit être passé en priorité. C’est un tout petit détail, mais une fois qu’on a intégré cela et qu’on a changé l’habitude c’est fait, on ne revient plus en arrière. Ce sont de petits changements qui peuvent faire une grosse différence sur un budget alimentaire sur une année.
Un autre outils que tu présentes c’est le calendrier du locavore. Comment en es-tu venue à développer ce calendrier?
C’est en écrivant le livre, David aux éditions Écosociété m’a suggéré de faire un calendrier et j’ai trouvé que c’était vraiment une bonne idée. C’est drôle parce que c’est quelque chose que je mets en place dans mon entreprise, d’avoir des calendriers pour se libérer de la charge mentale. Au lieu de tout le temps, pensez à ce qu’il faut faire. Quand c’est écrit, on a juste à suivre notre calendrier. Le calendrier locavore, c’est vraiment une proposition pour que chacun se fasse sa propre version de son calendrier: dépendamment si on a un jardin ou non par exemple.
C’est aussi un moyen de répartir les bonnes intentions du début janvier. Au lieu de simplement prendre des résolutions, on peut se donner des objectifs pour l’année en se donnant aussi la chance de ne pas tout réaliser. Ça permet de libérer la charge mentale et de se donner de petits objectifs pour changer nos habitudes.
On peut aussi se faire un registre de transformation planifié chaque année pour se rappeler la quantité de fraises qu’on avait congelé en juin l’an passé. Si on a manqué ou on a eu trop de fraises et si on sait grâce à notre registre quelle quantité de fraises on avait congelée, on va être capable d’ajuster les bonnes quantités pour l’année suivante.
D’un point de vue plus philosophique, un tel calendrier nous permet de nous reconnecter aux cycles de la nature. On réapprend à manger et à planifier nos activités selon les saisons de l’année.
Bien oui, au lieu de chialer contre notre climat, embrassons notre climat qui est extraordinaire. On a la chance d’avoir 4 belles saisons, avec une alternance d’activités! Moi j’ai découvert la chicorée en hiver, ça ressemble à une grosse laitue romaine, mais c’est plutôt dans la famille plus proche de l’endive. Ça a un petit goût légèrement amer, mais ça se conserve pendant des mois en chambre froide. J’adore ce petit goût croquant en hiver. Pour moi quand novembre arrive, j’adore, je capote, j’en mange tout l’hiver. L’été je n’ai pas du tout le goût de manger ça, j’y vais plutôt avec les mescluns, la roquette, etc. Mais le fait de varier, d’alterner, on ne se tanne jamais.
Les abonnées de panier me le disent, quand ils découvrent l’alimentation saisonnière, ils sont tellement contents… de se sentir plus connectés avec notre terroir, avec nos saisons et d’adapter leur mode de vie. Ce sont toutes des choses que lorsque les gens (re)découvrent ça, il y a un sentiment de bien-être qui vient.
Tu expliques que les recettes devraient s’adapter au fil des saisons. Par exemple, notre bol de crudités du printemps devrait être très différent de celui de l’automne
Tout à fait, et j’aime bien les recettes aussi – la soupe tonkinoise, le poké bol ou les rouleaux de printemps – c’est un peu comme les crudités. C’est-à-dire qu’on met des légumes qui vont varier selon les saisons. On peut aussi jouer avec les textures: les couper en julienne, en rondelle, râpée.
De varier les couleurs. La façon dont je mange ça à la maison, je mets tous ces légumes-là sur la table et chacun rempli son bol, son rouleau ou sa soupe avec les légumes dont il a envie. Dans cette approche-là ce qui est intéressant, c’est que ça ne sera jamais les mêmes légumes ou la même chose même si je le fais à l’année. Ça permet aussi de manger autrement. J’ai lu que les femmes avaient arrêté de cuisiner. Un peu dans l’élan du féminisme pour se libérer de ce fardeau-là qui incombait aux femmes. J’ai des femmes qui, parce qu’ayant eu des mères féministes, n’ont pas appris à cuisiner parce que c’était un statement féministe: “si tu ne veux pas cuisiner, ne cuisine pas”.
Je pense que c’est important aussi de se réapproprier la cuisine, mais sans se réapproprier le fardeau ou l’étiquette du recevoir – placer ces ustensiles, faire son plan de table, ouvrir ou pas la bouteille de vin qu’ils ont apportée. On peut se libérer de tout ce carcan là de la bobonne des années 50 et apprendre à cuisiner et à recevoir autrement.
Au lieu de cuisiner pour la visite, faites-la arriver plus tôt à 5h, prenez un petit verre de vin et cuisinez ensemble. Que ce soit des sushis ou des rouleaux de printemps ou des pokes bowl. Y’a juste les légumes qu’on met sur la table et après ça chacun fait son repas et sa propre assiette. Et ça enlève toute la charge mentale. Faire des rouleaux pour tout le monde ou faire le sien, on n’est pas dans le même genre de projet là! 🙂 C’est le genre de repas que j’aime bien.
Pourquoi ce qu’on produit au Québec n’est pas disponible en tout temps au Québec? Et comment gères-tu tes surplus?
Parfois on n’a quelques surplus et c’est ça qui est beau du réseau de fermier de famille. C’est qu’au lieu d’aller vendre à des distributeurs, souvent on va se vendre entre nous à l’intérieur du réseau. Donc on sait que ça a été produit dans des entreprises similaires. On sait qu’il y a différentes certifications bio: il y a du conventionnel qui ont 3-4 champs et qui font du bio… c’est certifié, mais on n’est pas tout à fait dans les mêmes valeurs écologiques et solidaires.
On s’assure de maintenir ces liens-là entre consommateurs et producteurs. De telle sorte que nous à la ferme on produit une très grande diversité – une soixantaine – donc l’été c’est très très rare qu’on a besoin d’acheter certains produits. Mais on va acheter des fruits qu’on ne produit pas – on produit juste du melon et de la cerise de terre. On achète des fraises d’une ferme qui est toujours la même chaque année. Le maïs aussi, on ne peut pas le produire dans notre région, il fait trop froid. On en achète pour satisfaire nos abonnés.
En hiver, quand on arrive à l’automne on réalise qu’on a un petit surplus de betterave, donc là on réussit à en vendre à des épiceries locales ou à d’autres fermes. En hiver, on a un distributeur qui peut nous approvisionner en tomates de serre du Québec – à Saint-Jérôme on a des serres qui peuvent nous approvisionner. Parfois on va les chercher directement, parfois on passe par un distributeur.
Parfois il y a des légumes qu’on pourrait produire en hiver localement, mais les consommateurs ne seraient pas prêts à payer le prix. Récemment il y a eu un reportage sur des serres qui produisaient du céleri, mais je connais les coûts de production du céleri et je ne pense pas que les gens seraient prêts à payer 9$ pour un céleri. Mais c’est ça que ça coûterait, parce que quand on chauffe une serre de -20 à + 5, c’est quand même 25 degrés de plus.
Oui c’est possible de produire du céleri à l’année au Québec, mais le consommateur on sait déjà qu’il ne sera pas prêt à payer le prix ou qu’il va falloir l’expliquer à chacun des clients et que ça va être une discussion interminable pour arriver à vendre au juste prix.
C’est pour ça que j’aime mieux donner des trucs, accompagner les gens à manger de saison, et à découvrir le céleri-rave au lieu d’espérer avoir du céleri du Québec produit en serre à l’année. Les produits de serre au Québec, s’ils sont disponibles, il faut être conscient que c’est un luxe. Donc peut-être que de manger des tomates tous les jours comme en été, on se dit qu’on en achète moins, plus à l’occasion pour la fin de semaine, pour un petit souper. Il faut reconnaître le caractère précieux et particulier de ces aliments-là. Tout comme les aliments importés.
À chaque fois qu’on mange du chocolat, on devrait se dire quelle chance on a de pouvoir mangé du chocolat! C’est un produit qui vient de loin, qui a subi beaucoup de transformations.
Et ça se peut qu’avec les changements climatiques on nous annonce que peut-être que la production de cacao ne sera plus possible. Mais on est dans une culture où le gaspillage alimentaire montre à quel point on ne reconnaît pas la valeur du travail et des ressources qui sont nécessaires pour produire les aliments.
Je pense que la valorisation est un des éléments clés pour contrer le gaspillage. Dans nos infolettres, quand les abonnés réalisent tout le travail nécessaire, quand ils voient des photos de nous dans le champ à désherber à quatre pattes. Qu’on leur explique tout le cycle de production, ils prennent conscience de la valeur et ils ne veulent pas gaspiller un seul morceau de légume de leur panier bio.
Est-ce que c’est mieux d’acheter une tomate du Mexique en hiver ou d’acheter une tomate de serre du Québec? Qu’est-ce qui est le plus écologique?
Ce qui est écologique c’est d’arrêter de manger des tomates fraîches en hiver! 🙂 Quand on s’en prive et que les premières tomates arrivent, on les déguste d’une façon complètement différente. Mais c’est vrai que souvent on ne pense même pas à cette option-là, qui serait de manger, finalement, selon les saisons.
Ressources pour aller plus loin